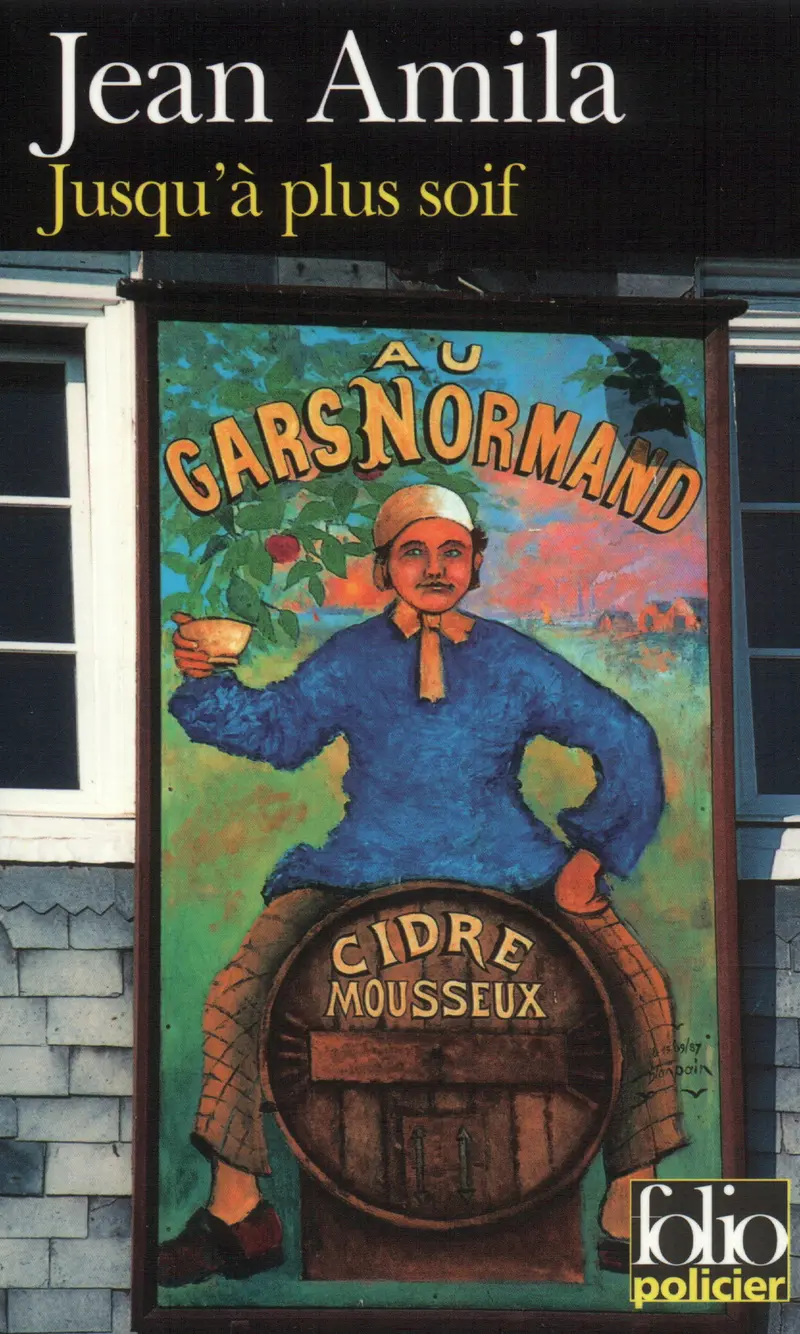Une mise au point pour commencer, puisque l'auteur de ces lignes est Normand de souche (terrienne, au fond du bocage derrière le pommier à droite), et que je ne saurais discuter à Jean Amila le juste point de vue qu'il porte sur les penchants alcoolisés de mes compatriotes, un statut qui n'est pas exclusif à ces contrées puisqu'il est avéré que, de Mulhouse à Biarritz et de Dunkerque à Toulon, le Français s'arsouille, et s'arsouille parfois de manière congénitale. Il est vrai que le Normand, à l'instar du Breton avoisinant, est un client sérieux, à même de faire glisser sous le comptoir n'importe quel adepte de l'apéro-muscadet ou du p'tit jaune matinal.
Amila a déjà eu le paysan normand dans sa visée, qu'on se souvienne de La lune d'Omaha, et son aréopage de petites gens sans envergure, mais au pouvoir de nuisance sûr et sournois. Ecrit dans les années 60, Jusqu'à plus soif peut apparaître aujourd'hui comme le pur produit de l'imagination de l'écrivain (qui n'en manquait pas), mais il n'est pas sûr que celles et ceux qui ont grandi dans ce genre de petit village durant l'après-guerre, dans l'Orne, le Calvados ou ailleurs, n'y retrouvent pas quelques lampées de vérité à l'arrière-goût de pomme et d'alcool qui rend fou.
A Domfront débarque un jour Marie-Anne et ses toutes fraîches résolutions de nouvelle institutrice. Dans la charrette qui l'amène, cuve à ses côtés le curé du village, brave homme bedonnant qui liquide (apprend-t-on plus tard dans le livre), ces 100 litres de « goutte » à l'année. Sur le bas-côté, les ombres affairées de paysans autour d'un alambic gigantesque à peine caché au milieu d'un champ. Et à son arrivée, on apprendra, à peine ému tant la chose parait courante, la mort d'une servante, qui s'est noyée ivre morte dans une mare.
A Domfront, les gamins amènent leur petite bouteille de goutte au café pour la récré, et la Directrice de l'école ne comprend pas trop en quoi ça gêne. A Domfront les bouilleurs de cru font tourner la maréchaussée en bourrique, et ça a toujours fait partie du folklore. A Domfront, la production d'alcool est tellement importante qu'elle s'exporte vers Paris et c'est là que le grand trafic s'en mêle, que les politicards locaux jouent aux aigrefins, que les vrais malfrats entrent dans la danse et que le roman noir commence.
C'est, à vrai dire, la partie la plus accessoire du roman, la moins longue mais pas la moins bonne ; lorsque le petit paysan se heurte au réalisme économique et aux méthodes carnassières de la pègre parisienne, il y laisse des dents. Amila décrit avec plus d'emphase et de ressentiment les mentalités basses de plafond du petit Français imbibé, de la populace prompte à montrer du doigt, vilipender et lyncher. Pour défendre ce droit indéracinable à l'éthylisme atavique et à la perpétuation de générations d'idiots, la cohésion est forte chez les Domfrontais !
La méchanceté de l'auteur peut se voiler derrière une once de commisération, Amila possède cette acuité sans merci du vieil anar, quelque part entre la haine de Céline et la moquerie de Marcel Aymé. Une vigueur de style ainsi qu'une aigreur de point de vue qui rendent aujourd'hui encore sa lecture décisive, toujours d'actualité.